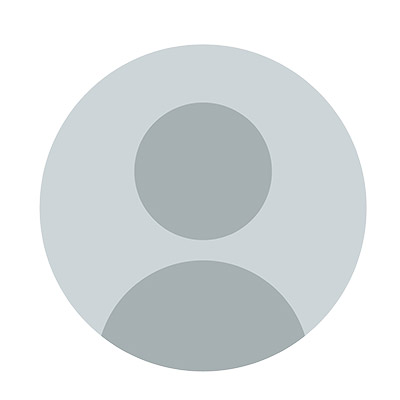Le 11 novembre 1918, lorsque retentissent les clairons de l’Armistice, un pan entier de la France se recueille loin de l’Hexagone. De la Guadeloupe à la Réunion, de la Martinique à la Guyane, de la Polynésie à la Nouvelle-Calédonie, des milliers d’hommes, citoyens des « vieilles colonies » ou sujets engagés volontaires, ont laissé dans les tranchées d’Europe, sur les plaines de Champagne ou les marécages de l’Aisne, une part de leur jeunesse et, trop souvent, leur vie.
Un siècle plus tard, alors que l’on commémore ce 11 novembre, leurs noms et leurs visages émergent enfin des archives, des monuments aux morts et des récits familiaux. Raconter leur histoire, c’est restituer à la Nation une vérité simple : la victoire de 1918 fut aussi ultramarine.
« Vieilles colonies », nouveaux citoyens, et l’appel des armes
À la veille de la Grande Guerre, l’intégration politique des Antilles-Guyane et de la Réunion dans la France républicaine est ancienne, mais inégalement réalisée. Le service militaire universel, principe cardinal de la citoyenneté, s’y applique tardivement et incomplètement. Lorsque la mobilisation générale sonne en août 1914, les gouverneurs coloniaux activent réseaux préfectoraux, municipaux et paroissiaux. La propagande patriotique s’ajoute à l’élan sincère : on s’enrôle « pour la Patrie », parfois aussi pour l’ascension sociale, l’aventure, la solde ou l’espoir d’une reconnaissance. Des jeunes Antillais partent vers la Somme, Verdun, le Chemin des Dames ; d’autres, orientés vers l’Armée d’Orient, découvrent la Grèce, les Dardanelles, les rives de la Strouma. Dans le Pacifique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie fournissent des contingents de tirailleurs ; on y crée, en 1916, le Bataillon des tirailleurs du Pacifique (bientôt appelé Bataillon mixte du Pacifique) où Kanak et Tahitiens combattent côte à côte.
Cette mobilisation n’alla pas sans déchirements. En Nouvelle-Calédonie, le recrutement d’indigènes, la crise économique et l’autoritarisme administratif nourrissent la grande révolte kanak de 1917, réprimée au prix d’une violence qui marquera durablement les mémoires locales. À l’autre bout de l’Empire, les « coloniales » (infanterie et artillerie héritières de la Marine) dispersent les Antillais dans des dizaines de régiments. La guerre est « totale » : elle réquisitionne l’économie insulaire, raréfie les vivres, bouleverse les familles. Mais elle crée aussi une fraternité d’armes et de deuil entre les rives de l’Atlantique, de l’océan Indien et du Pacifique.
Le stratège venu de Pointe-à-Pitre : Camille Mortenol, bouclier de Paris
Né en 1859 à Pointe-à-Pitre dans une famille affranchie de l’esclavage, Camille Mortenol incarne la promesse et les contradictions de la République coloniale. Élève brillant repéré par Victor Schœlcher, premier Noir admis à l’École polytechnique au XIXe siècle, officier de marine aguerri des campagnes lointaines, il se heurte, sa vie durant, au plafond de verre des préjugés. En 1915, le gouverneur militaire de Paris, le général Gallieni, lui confie pourtant une mission cruciale : organiser la Défense contre aéronefs (DCA) du camp retranché de Paris.
Mortenol déploie un système d’alerte et de riposte d’une modernité remarquable : postes de guet en ceinture rurale, réseau de téléphones et de signaux lumineux, extinction coordonnée des feux de la capitale, batteries antiaériennes et puissants projecteurs pour aveugler dirigeables et bombardiers ennemis. Entre 1915 et 1918, les raids sur Paris se heurtent à cette architecture défensive ; la ville souffre, mais tient. À la fin de la guerre, Mortenol est fait commandeur de la Légion d’honneur, salué pour son « rare dévouement et sa compétence éclairée ». Longtemps restée à la marge du roman national, sa figure s’impose aujourd’hui comme l’emblème d’une élite ultramarine au service de la République.
Ciel de guerre : des « pionniers de l’air » nés sous les alizés
La Première Guerre mondiale est aussi celle de l’aviation, cette arme nouvelle où s’inventent tactiques, machines et mythologies. Deux noms ultramarins s’y détachent.
Le Réunionnais Roland Garros (1888-1918), pionnier de l’aéronautique civile devenu as de chasse, met au point, avec l’ingénieur Raymond Saulnier, un dispositif permettant de tirer « à travers » l’hélice grâce à des déflecteurs métalliques, innovation décisive qui précède la synchronisation mise au point côté allemand. Capturé en 1915, évadé en 1918, il reprend le combat malgré une santé brisée et tombe à quelques jours de l’Armistice, abattu au-dessus des Ardennes. Son nom reste attaché à un stade et à un tournoi ; il devrait l’être tout autant à cette audace technicienne née sur une île de l’océan Indien.
Le Martiniquais Pierre Réjon (1895-1920) appartient au petit cercle des tout premiers pilotes militaires afro-descendants. Élève ingénieur devenu aviateur, breveté en 1917, il vole sur Nieuport puis sur SPAD au sein d’escadrilles de chasse, revendique plusieurs victoires et reçoit la médaille militaire et la croix de guerre pour « courage à toute épreuve ». Démobilisé vivant (rare privilège chez les pilotes) il se tuera accidentellement en Guyane, bouclant tragiquement une trajectoire de météore.
Dans la boue et le froid : Gustave Létard, un « Poilu » de Guyane
La guerre, c’est d’abord l’enfer terrestre des tranchées. Gustave Létard (1892-1963), né à Sinnamary, en témoigne par son parcours heurté. Mobilisé en 1915, d’abord aide de camp, il est rattrapé par la logique implacable du front et bascule dans la Somme, où la pneumonie l’abat. Les hasards dramatiques de la logistique de guerre (un dossier perdu dans un torpillage au large des Açores) retardent sa démobilisation ; le voici renvoyé au feu, canonnier au 78e régiment d’artillerie lourde sur voie ferrée, puis expédié vers l’Orient. Il voit des pièces et des équipes entières pulvérisées, raconte « le plus mauvais moment de [son] existence » dans les Dardanelles, et ne rentre à Cayenne qu’au printemps 1919. Devenu agriculteur, puis élu local, il incarne ces milliers d’Antillo-Guyanais dont la bravoure ne se mesure ni aux communiqués d’état-major ni aux panthéons, mais à la ténacité des revenants.
Le « bataillon des antipodes » : Kanak et Tahitiens vers la Marne
Créé en 1916, le Bataillon des tirailleurs du Pacifique qui deviendra le Bataillon mixte du Pacifique (BMP) réunit volontaires kanak de Nouvelle-Calédonie et Polynésiens. Le premier temps est celui de l’« étape » : campements à Fréjus, corvées de manutention à Marseille, maladies et mortalité. Puis vient l’épreuve du feu. À l’été 1918, le BMP est engagé dans la seconde bataille de la Marne, puis sur la ligne Hindenburg. En octobre 1918, devant Vesles-et-Caumont (Aisne), il enlève le village et la ferme du Petit-Caumont au prix de pertes sévères ; l’un des siens, le Lifou Saiaeng Wahena (1887-1918), tombe dans un assaut nocturne, enfoncé jusqu’aux genoux dans la glaise. La Xe armée cite le bataillon à l’ordre ; le général Mangin lui remet sa décoration en décembre. Le BMP sera dissous en mai 1919, mais sa mémoire, longtemps locale — noms gravés aux monuments de Nouméa, stèles rappelant la saignée — a depuis franchi les océans.
Le Polynésien Pierre Bernière (1897-1915), élève boursier en France en 1914, s’engage au 21e régiment d’infanterie coloniale. Promu sergent à dix-huit ans, blessé, décoré, il meurt en Champagne le 25 septembre 1915. Dans les Établissements français d’Océanie, sa bravoure devient symbole : la jeunesse tahitienne tient là son « poilu sans peur et sans reproche », dont la trace court des colonnes du Journal officiel aux mémoires familiales. Sa trajectoire, brève et lumineuse, dit l’essentiel : l’égalité devant la mort fut, hélas, la plus concrète des égalités républicaines.
Chiffres, silences et dettes
Combien furent-ils ? Les statistiques varient selon les corps et les définitions, mais l’ordre de grandeur est connu : des centaines de milliers de soldats « coloniaux » furent mobilisés par la France, dont des dizaines de milliers venus des vieilles colonies antillaises, de la Guyane et de la Réunion ; plus d’un millier du seul BMP pour le Pacifique. Ils combattirent sur tous les fronts, souffrirent des hivers européens, des fièvres balkaniques, des obus à shrapnels et des gaz. Beaucoup ne revinrent pas ; d’autres revinrent brisés, gazés, amputés. Les pensions tardèrent, l’égalité des droits aussi. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, des monuments « aux morts pour la France » s’élevèrent, mais le récit national demeura parcimonieux à reconnaître la part ultramarine de la victoire.
Ce silence n’est pas anodin : il a nourri, durant des décennies, un sentiment d’injustice chez les descendants de ces combattants. Il a aussi appauvri la compréhension que la France a d’elle-même. Car la Grande Guerre, matrice du XXe siècle, a scellé dans le sang une communauté de destin entre l’Hexagone et ses Outre-mers. De Pointe-à-Pitre à Papeete, de Fort-de-France à Nouméa, le 11 novembre n’est pas une date importée ; c’est une mémoire propre, inscrite dans les lignées, les toponymes, les cimetières.
Depuis une trentaine d’années, un patient travail de restitution s’est engagé. Des chercheuses et des musées ont fait parler les registres, les cartes postales, les lettres griffonnées à la bougie dans les abris, les photographies prises au camp des Darboussières. Des conteuses en Guyane, sillonnant le Maroni, ont mis en scène cette mémoire (« Mo papa té sodà » – « Mon père était soldat »), révélant la profondeur des traces. En Nouvelle-Calédonie, des classes entières ont enquêté sur les 164 hommes partis de Lifou, recollant fratries et destins autour de Vesles-et-Caumont ; à Nouméa, des stèles ont enfin gravé les noms des tirailleurs kanak tombés en 14-18.
Cette réappropriation n’est pas qu’un devoir envers les morts ; elle est un miroir tendu à nos débats contemporains. Elle rappelle que l’universalité républicaine fut (et reste)une promesse à tenir. Elle dit que l’héroïsme n’a ni couleur ni latitude, mais des circonstances, des contextes, des épreuves particulières. Elle invite, en ce 11 novembre, à entendre la polyphonie d’une France-monde.
Une fraternité d’Outre-mer
Il y a, dans la figure de Camille Mortenol veillant Paris « jour et nuit », dans la course ultime de Roland Garros vers Vouziers, dans l’ascension d’un Pierre Réjon contre des adversaires supérieurs en nombre, dans la résilience d’un Gustave Létard balloté d’un front à l’autre, dans l’assaut fatal de Saiaeng Wahena à Vesles-et-Caumont, dans la jeunesse fauchée de Pierre Bernière, une cohérence silencieuse : celle d’une loyauté éprouvée. Ils n’étaient pas des figurants exotiques de l’épopée de 14-18 ; ils en furent des acteurs essentiels, comme des milliers d’autres anonymes.
Le 11 novembre 2025, à l’heure où les cloches sonnent et où les drapeaux s’inclinent, ayons une pensée pour ces « poilus des antipodes ». Que les écoliers de Basse-Terre, de Schoelcher, de Cayenne, de Saint-Denis, de Papeete et de Nouméa sachent que leurs arrière-grands-pères ont veillé sur Paris, franchi la Marne, tenu la Somme et affronté l’hiver de Champagne. Et que la République, en retour, continue d’inscrire leurs noms, tous leurs noms, dans la pierre, dans les manuels, dans les cérémonies et, surtout, dans la conscience commune. C’est ainsi que se tisse, au-delà des océans, la trame d’une mémoire réellement nationale.
Radouan Kourak et Michel Taube