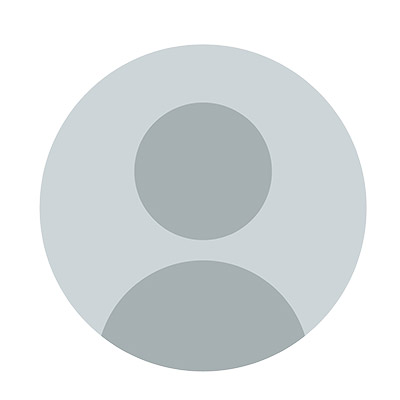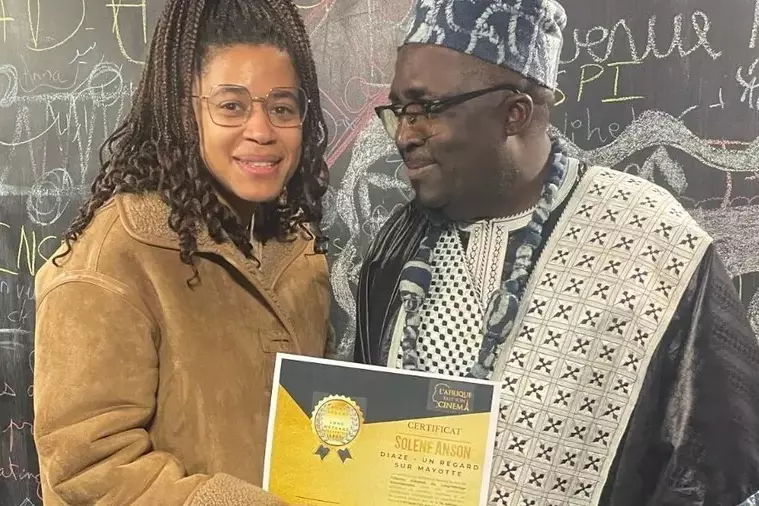Les croisières sont devenues un symbole du tourisme mondialisé, et les Outre-mer en sont une vitrine majeure. Chaque année, des navires toujours plus imposants accostent dans les ports de Guadeloupe, de Martinique, de Polynésie ou de La Réunion. Des milliers de passagers débarquent pour quelques heures, offrant l’image d’un dynamisme touristique retrouvé. Pourtant, la réalité est plus complexe : la manne économique annoncée profite peu aux territoires, tandis que les conséquences environnementales deviennent difficilement soutenables.
En 2024, la Martinique a battu un record avec plus de 450 000 passagers. En Polynésie, les escales quotidiennes se multiplient, et à La Réunion, les investissements portuaires s’accélèrent pour accueillir les paquebots géants. Mais à terre, les retombées demeurent faibles. La plupart des croisiéristes consomment à bord, dans les restaurants, casinos et boutiques des navires, réduisant à la portion congrue les bénéfices pour les commerces locaux. Ce modèle, typiquement mondialisé, échappe largement aux économies ultramarines. Pour en inverser la logique, il revient aux élus et aux acteurs économiques locaux de s’imposer dans la négociation avec les grandes compagnies internationales, en exigeant des retombées tangibles pour les populations.
Sur le plan écologique, le constat est tout aussi préoccupant. Ces villes flottantes consomment plusieurs centaines de litres de carburant à l’heure et rejettent dans l’atmosphère des quantités colossales de gaz à effet de serre. Les armateurs se vantent de progrès techniques — propulsion au gaz naturel liquéfié, recyclage des eaux usées, gestion des déchets — mais ces améliorations restent insuffisantes face à l’ampleur des émissions. Sous couvert de modernité, le secteur perpétue une forme de dépendance : dépendance économique des territoires, dépendance énergétique des navires, dépendance politique d’États souvent complaisants à l’égard de cette industrie puissante.
Pourtant, il existe un chemin français, responsable et ambitieux. Il passe par une meilleure régulation, un renforcement des infrastructures portuaires publiques, la formation des professionnels locaux et la mise en œuvre de normes environnementales exigeantes. C’est dans cette voie que la France peut concilier l’accueil touristique et la protection de ses territoires, en refusant que les Outre-mer deviennent de simples escales de consommation. Les îles françaises doivent rester des terres de vie, pas des vitrines éphémères pour le tourisme mondialisé.