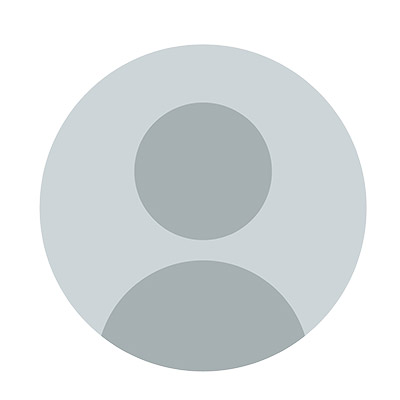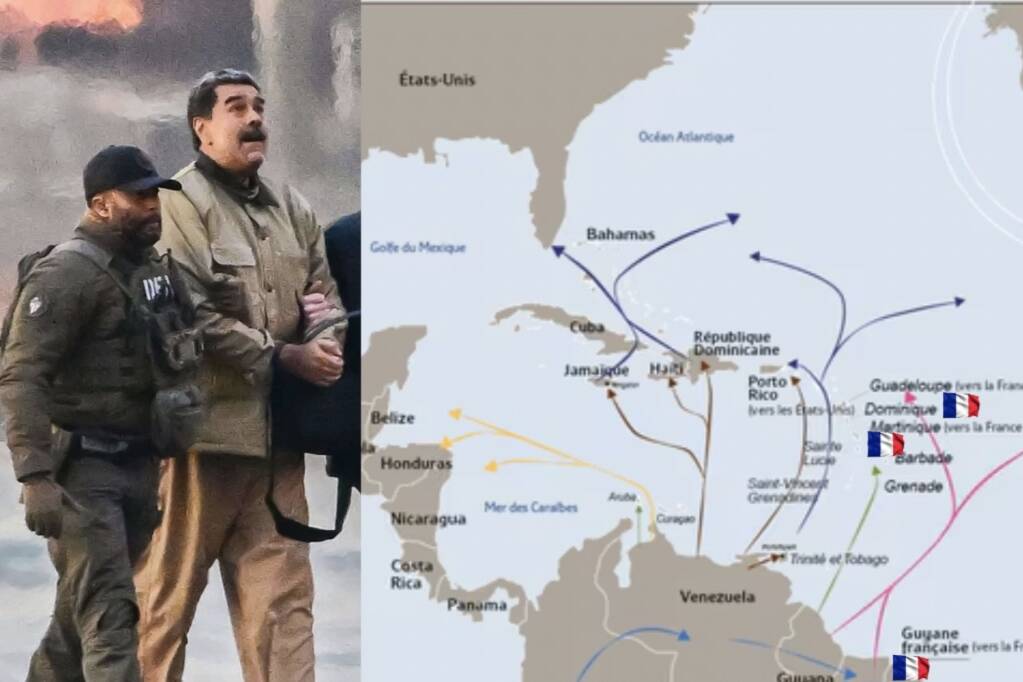La publication du dernier rapport de la Chambre régionale des comptes est sans appel : au rythme actuel, il faudrait plus de deux siècles au SMGEAG pour renouveler l’intégralité du réseau de distribution en Guadeloupe. Une conclusion qui illustre l’ampleur du désastre et confirme ce que vivent au quotidien des milliers de familles confrontées à des coupures, à des contaminations ou à des tours d’eau incessants.
Créé en 2021 pour mettre fin à la dispersion des opérateurs, le syndicat unique peine à démontrer son efficacité. Malgré un plan d’investissement de 165 millions d’euros abondé par l’État et l’Europe, ainsi que 35 millions d’euros apportés par les collectivités locales, les résultats restent dérisoires : 15 km de conduites remplacés par an, 18 000 compteurs changés en une année, 9 000 fuites réparées. Des chiffres qui paraissent conséquents mais qui, rapportés à l’état réel du réseau, traduisent l’impossibilité d’un retour à la normale sans un changement radical d’échelle.
Face à cet immobilisme, certaines intercommunalités, à l’image de Cap Excellence, cherchent déjà à se substituer au syndicat pour lancer elles-mêmes les travaux urgents. Mais ces initiatives ponctuelles ne suffiront pas à combler des décennies de sous-investissement et de gestion hasardeuse. La situation exige un pilotage fort, clair et assumé, à la hauteur de l’intérêt national que représente l’accès à une eau potable de qualité.
Car au-delà de la Guadeloupe, cette crise interroge la place des Outre-mer dans la République. Alors que le droit à l’eau est universel, il est inconcevable que des territoires français connaissent une telle pénurie chronique, digne d’un pays en développement. L’État ne peut se contenter d’apports financiers dispersés ; il doit reprendre la main, assurer une gouvernance ferme et transparente, et faire en sorte que les Guadeloupéens bénéficient des mêmes standards de service public que n’importe quel citoyen français.