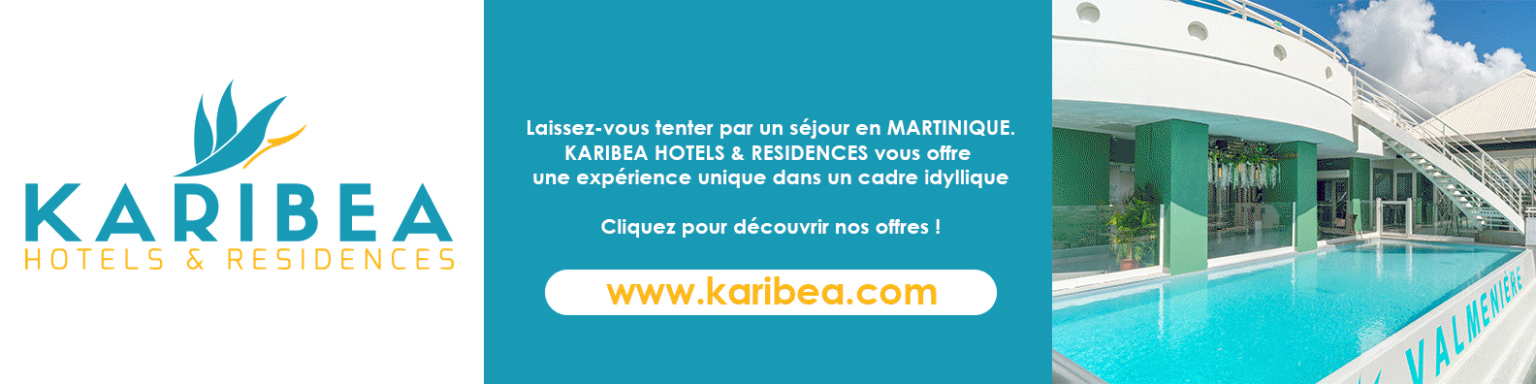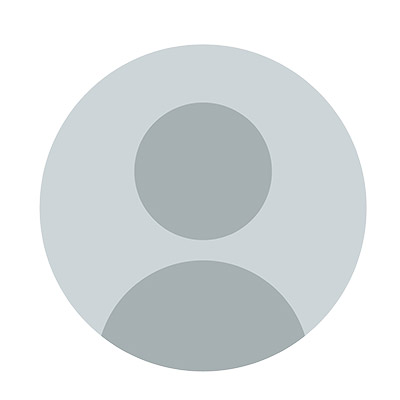Cinq ans après les faits, la justice s’apprête à trancher sur une affaire qui a profondément marqué la Martinique et, au-delà, l’opinion nationale. Ce mercredi 5 novembre, plusieurs jeunes militants du collectif Rouge-Vert-Noir comparaissent devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour la destruction de statues à Fort-de-France et Schoelcher en 2020 dont celles de Victor Schoelcher, Joséphine de Beauharnais et Pierre Belain d’Esnambuc, symboles historiques de la colonisation et de l’abolition de l’esclavage.
Ces actes de vandalisme avaient été revendiqués comme un “acte de libération symbolique” par leurs auteurs, qui réclamaient que les monuments “non représentatifs du peuple martiniquais” soient retirés de l’espace public. Des vidéos de ces scènes, diffusées sur les réseaux sociaux, avaient suscité une onde de choc : certains y voyaient une atteinte à la mémoire collective et à la République, d’autres une “réappropriation de l’histoire” par une jeunesse en quête d’identité.
Mais la justice, elle, juge des faits. Ces destructions d’édifices publics relèvent du délit, et la fermeté de la réponse judiciaire sera observée comme un signal. Plusieurs associations et élus locaux appellent d’ailleurs à ne pas céder à la pression des activistes, soulignant que la mémoire nationale ne peut être réécrite à coups de masse.
Au-delà du procès, c’est bien la question du rapport entre mémoire et unité nationale qui se joue en Martinique. Entre revendication identitaire et respect de l’ordre républicain, la France doit rappeler que son Histoire avec ses ombres et ses lumières appartient à tous ses citoyens, et ne saurait être détruite sous l’émotion ou la colère.