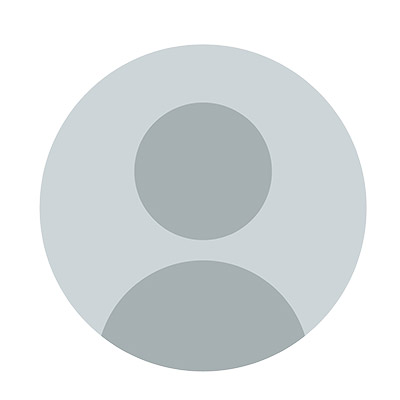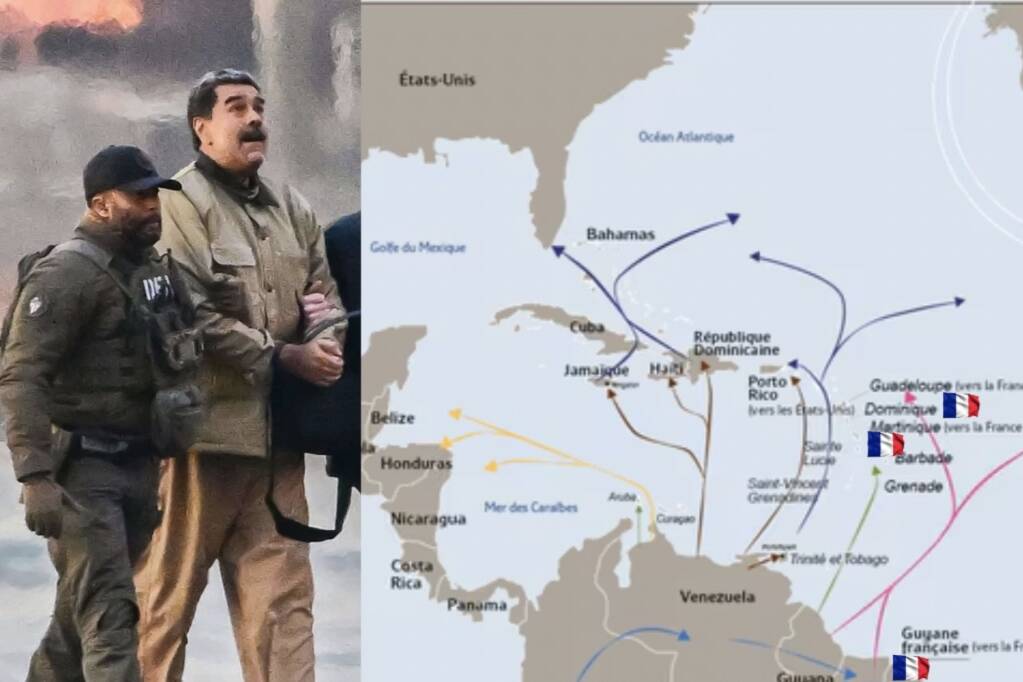Pilier historique de l’économie de La Réunion, la canne à sucre traverse une crise profonde. Avec une production annoncée à moins d’un million de tonnes en 2025, la filière signe une nouvelle année noire malgré un soutien massif de l’État et de l’Europe.
Une production en chute libre et une dépendance accrue aux aides
Le cyclone Garance, survenu en début d’année, a anéanti une partie des cultures. Les deux usines de l’île, calibrées pour deux millions de tonnes de cannes, n’en recevront qu’environ 900 000 cette saison. Ce recul s’ajoute à une production déjà “historiquement basse” en 2024, selon la chambre d’agriculture. Les usines tournent désormais en dessous de leur seuil de rentabilité, menaçant des centaines d’emplois directs et indirects.
Pour éviter l’effondrement, la filière bénéficie de 148 millions d’euros d’aides publiques par an, dont 70 % pour les producteurs. Le groupe Tereos, seul industriel sucrier de l’île, reçoit à lui seul 44 millions d’euros pour maintenir l’activité. En moyenne, 70 à 80 euros sur 100 du prix de vente d’une tonne de canne proviennent des fonds publics. “Nous vivons à 75 % des aides”, admet Dominique Clain, président du syndicat Unis pour nos agriculteurs.
Cette dépendance interroge le modèle agricole réunionnais. La canne occupe encore plus de la moitié des terres cultivées (22 600 hectares), mais ces surfaces reculent chaque année. Beaucoup de planteurs se tournent vers le maraîchage ou les cultures vivrières, plus rentables et moins dépendantes des aléas climatiques. Des voix s’élèvent aussi pour réduire l’usage des pesticides, notamment le glyphosate, encore largement employé sur l’île.
Face à ce déclin, les syndicats et les collectivités appellent à repenser le rôle de la canne dans l’économie locale. Sans remettre en cause son importance culturelle et sociale, ils plaident pour une diversification agricole plus ambitieuse, condition essentielle pour garantir la souveraineté alimentaire et l’avenir rural de La Réunion.