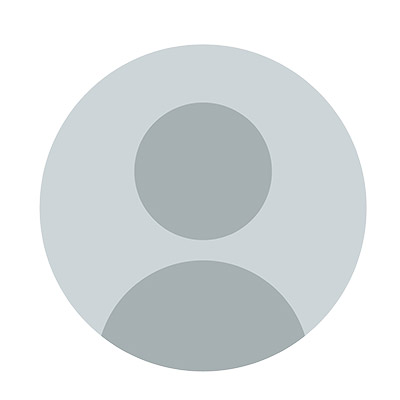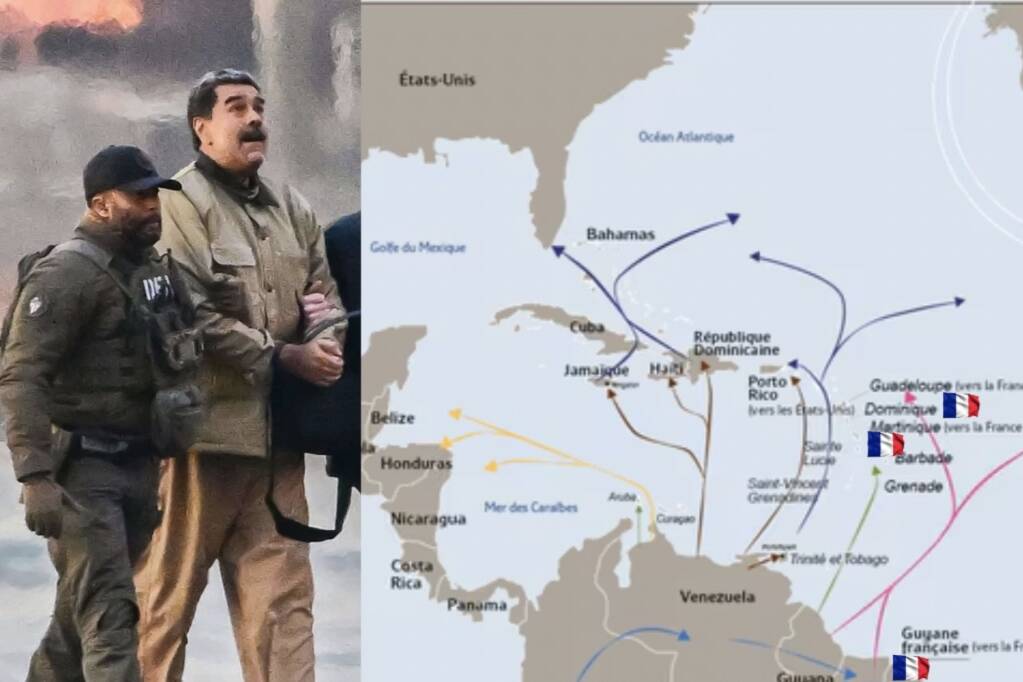À La Réunion, la ligne politique a été claire et sans nuance : tous les députés du territoire, de la gauche au Rassemblement national, ont voté pour la motion de censure déposée par La France insoumise. Une unanimité rare dans le paysage ultramarin, qui traduit moins une adhésion commune à un camp politique qu’un profond malaise face au manque de réponses concrètes du gouvernement.
Le vote des députés réunionnais
À La Réunion, c’est l’unanimité :
Philippe Naillet (PS – 1ʳᵉ circonscription) : pour la censure.
Karine Lebon (GDR – 2ᵉ circonscription) : pour la censure.
Joseph Rivière (RN – 3ᵉ circonscription) : pour la censure.
Émeline K/Bidi (GDR – 4ᵉ circonscription) : pour la censure.
Jean-Hugues Ratenon (LFI – 5ᵉ circonscription) : pour la censure.
Frédéric Maillot (GDR – 6ᵉ circonscription) : pour la censure.
Perceval Gaillard (LFI – 7ᵉ circonscription) : pour la censure.
Une unanimité dictée par la réalité économique
Derrière cette unité parlementaire se cache un constat largement partagé : La Réunion reste confrontée à une inflation persistante et à un coût de la vie qui fragilise les ménages comme les entreprises. Les prix à la consommation dépassent encore de 30 % ceux de la métropole, notamment dans l’alimentation et le logement.
Le gouvernement, en reprenant les bases du projet de loi sur la vie chère conçu à l’époque de Manuel Valls, affirme vouloir “rétablir l’équité économique”. Mais dans les faits, la mesure suscite de fortes réserves locales, y compris parmi les élus loyalistes, qui y voient une approche idéologique plutôt qu’économique.
Un projet qui rappelle les logiques d’économie administrée
Le texte prévoit de plafonner certaines marges, d’abaisser les seuils de contrôle de l’Autorité de la concurrence et d’imposer de nouvelles obligations de transparence aux distributeurs. Pour ses détracteurs, cette méthode revient à administrer l’économie, sans s’attaquer aux causes structurelles de la vie chère : dépendance aux importations, faiblesse de la production locale, coût du fret et des matières premières et déficit d’infrastructures de stockage.
“Ce n’est pas en décrétant un prix bas qu’on crée du pouvoir d’achat”, rappelle un économiste local. “C’est en baissant le coût des facteurs de production.”
Le besoin d’une continuité économique, pas d’un contrôle centralisé
Pour La Réunion, comme pour les autres Outre-mer, la véritable réforme consisterait à instaurer une continuité économique territoriale, sur le modèle de la Corse : compenser structurellement les surcoûts liés à l’éloignement, encourager les circuits courts et soutenir la production locale. Cette approche serait conforme à une logique libérale et territoriale, plutôt qu’à une politique de régulation venue d’en haut.