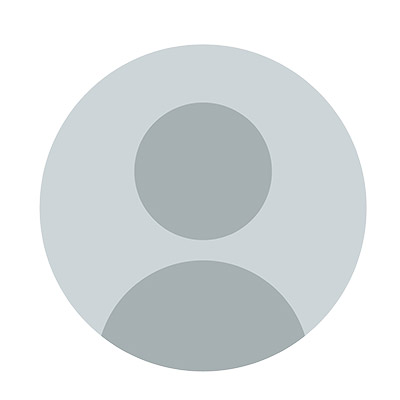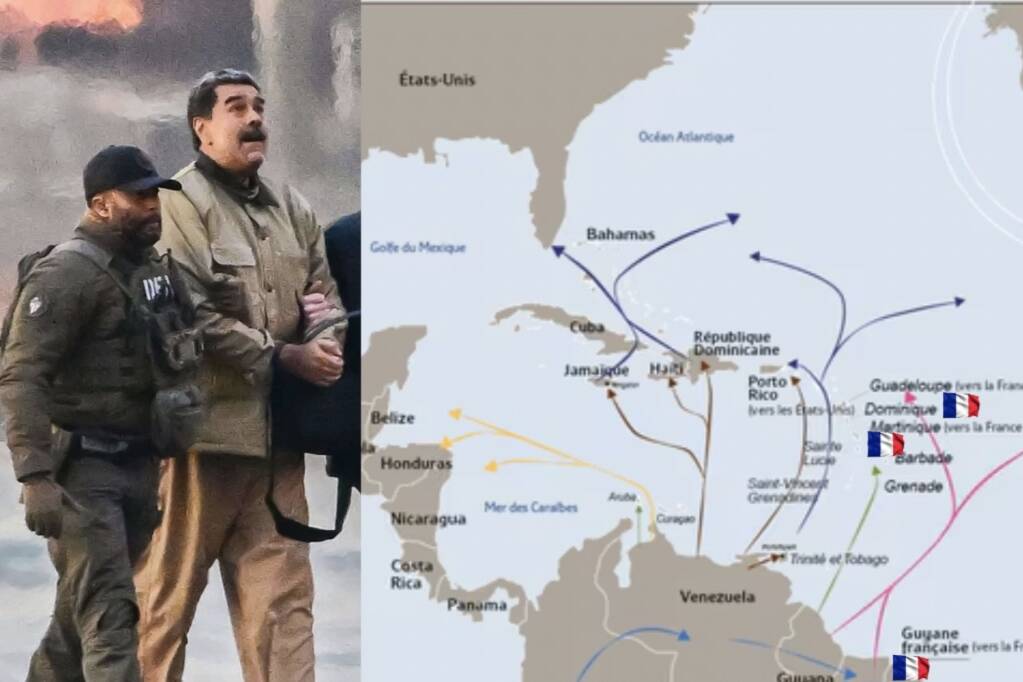Six ans après l’apparition du volcan sous-marin Fani Maore, à 50 km à l’est de Mayotte, la recherche française poursuit un travail d’une ampleur inédite dans l’océan Indien. Du 25 septembre au 14 octobre 2025, le navire océanographique Marion Dufresne accueillera la 33ᵉ campagne du Revosima (Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte), piloté par l’IPGP et le BRGM. Objectif : mieux comprendre la dynamique du volcan et de la chaîne de cônes volcaniques qui l’entoure.
Un champ volcanique actif et complexe
Contrairement à l’image classique du volcan isolé, Fani Maore fait partie d’une chaîne de reliefs sous-marins d’une cinquantaine de kilomètres de long. Certains se sont formés récemment, il y a quelques millénaires, et présentent encore une activité. Le système magmatique est vaste et complexe : des « lames de magma » empilées communiquent entre elles, non pas verticalement, mais horizontalement, sur des dizaines de kilomètres. Ce schéma pourrait expliquer l’éruption de 2019, sans que toutes les connexions profondes, notamment avec Petite-Terre, soient encore élucidées.
Une activité toujours surveillée
Si aucune éruption n’a été enregistrée depuis janvier 2021, les scientifiques insistent : le volcan n’est pas éteint. La zone reste « à probabilité non négligeable » d’une reprise éruptive. Les instruments permettent de dater les événements passés, mais pas de prédire l’instant d’une nouvelle crise. À cela s’ajoutent d’autres phénomènes volcaniques, comme les émissions de CO₂ observées au lac Dziani et à proximité de l’aéroport.
Une avancée scientifique mondiale
Depuis 2019, la surveillance volcanologique a bondi. Avant Fani Maore, aucune station n’était dédiée à Mayotte. En six ans, 32 missions océanographiques ont déjà été menées, la 33ᵉ visant à récupérer des capteurs au fond de la mer et à affiner l’imagerie des réservoirs magmatiques. Les chercheurs parlent d’un site « unique au monde », où cohabitent éruptions explosives et effusives, et qui pourrait devenir un laboratoire international du volcanisme sous-marin.
Vers un observatoire sous-marin permanent
À terme, le projet MARMOR ambitionne d’installer un observatoire câblé sous-marin, capable de transmettre en temps réel les données recueillies par les capteurs. Coût estimé : une quinzaine de millions d’euros. Si les financements sont réunis, Mayotte deviendrait pionnière dans la surveillance volcanologique sous-marine, un outil stratégique tant pour la recherche que pour la sécurité civile.