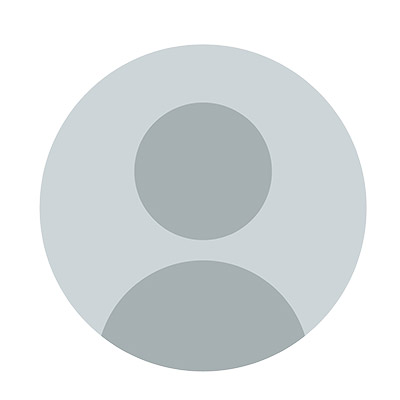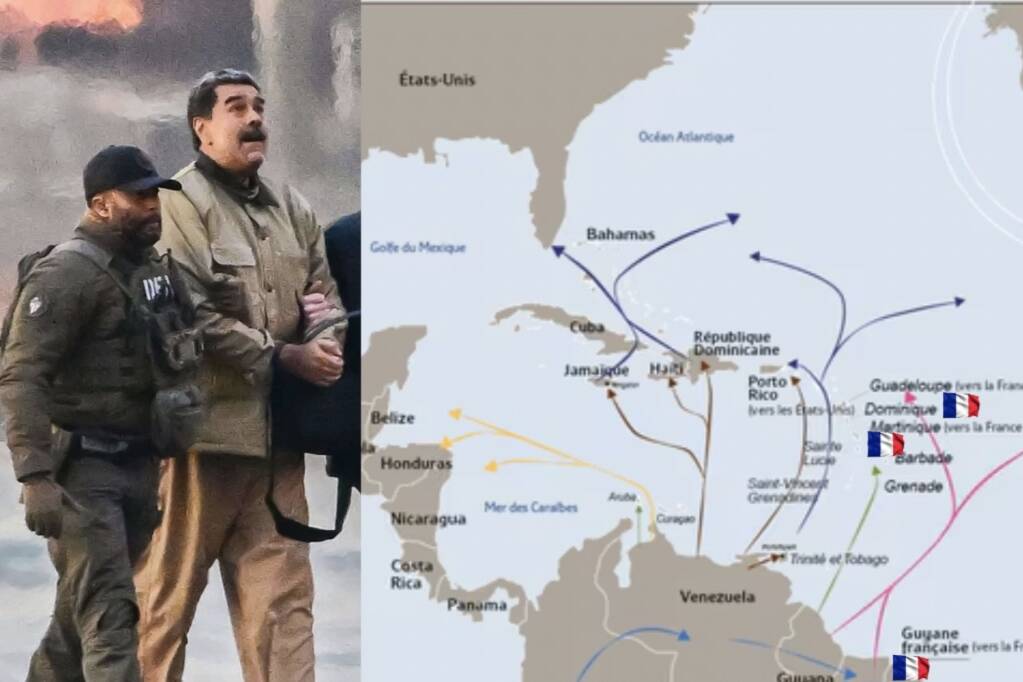À Mayotte, le vote sur la motion de censure contre le gouvernement Lecornu II illustre une fracture politique nette entre deux approches : celle de la contestation nationale portée par la députée RN Anchya Bamana, et celle du pragmatisme local incarnée par Estelle Youssouffa (Liot). Toutes deux ancrées dans la défense du territoire, elles se distinguent néanmoins par leur lecture des priorités et des leviers d’action.
Le vote des députées mahoraises
Estelle Youssouffa (Liot – 1ʳᵉ circonscription) : n’a pas voté la censure.
Anchya Bamana (RN – 2ᵉ circonscription) : pour la censure.
Anchya Bamana (RN), dans la ligne de son parti
Fidèle à la stratégie nationale du Rassemblement national, Anchya Bamana a voté pour la motion de censure. Son camp plaide pour un retour à la souveraineté populaire par une dissolution de l’Assemblée nationale et de nouvelles élections.
À Mayotte, cette position trouve un écho particulier. L’île concentre les fractures sociales et sécuritaires les plus graves du pays : immigration clandestine, explosion démographique, insécurité, pauvreté massive et crise sanitaire persistante. Pour la députée RN, la censure n’est donc pas qu’un acte politique symbolique : elle marque le rejet d’un État jugé impuissant à restaurer l’ordre et à garantir la continuité républicaine. En ce sens, son vote s’inscrit dans la ligne du parti qui estime que seule une refondation politique profonde, par les urnes, permettra de redonner aux Mahorais le contrôle de leur destin.
Estelle Youssouffa (LIOT), la stabilité avant tout
À l’inverse, Estelle Youssouffa, réélue dès le premier tour des législatives anticipées avec près de 80 % des voix (79,48 %), n’a pas voté la censure.
Son poids électoral considérable lui confère une légitimité qui dépasse les jeux de partis. Elle n’a pas besoin d’un nouvel appel aux urnes : son mandat repose sur la confiance massive de ses administrés. Son message est clair : “ma seule priorité, c’est Mayotte.”
Ancienne journaliste devenue figure incontournable de la vie politique locale, Youssouffa concentre son action sur la lutte contre l’insécurité, la maîtrise migratoire et la défense des services publics. Elle préfère donc la stabilité institutionnelle, estimant qu’une dissolution ne ferait que retarder les réponses concrètes à la crise mahoraise.
Un territoire symbole des fractures françaises
Mayotte est aujourd’hui le miroir grossissant des défis nationaux : immigration, insécurité, logement, pauvreté. Alors que la majorité gouvernementale peine à répondre à ces enjeux, les Mahorais expriment une colère qui dépasse les clivages traditionnels.
Dans ce contexte, la reprise du projet de loi sur la vie chère, hérité de Manuel Valls, est perçue ici comme un contresens : une réponse technocratique et centralisée à un problème qui, à Mayotte plus qu’ailleurs, relève de la sécurité, de la logistique et de la souveraineté. Plafonner les prix n’a guère de sens dans une île où les pénuries alimentaires, la contrebande et la dépendance aux importations fixent de fait la loi du marché. Ce que les Mahorais demandent, c’est d’abord de pouvoir vivre en sécurité et produire localement, avant de parler de régulation des prix.
À Mayotte, les deux députées incarnent deux visions d’un même combat : celle du choc politique, et celle de la continuité territoriale. Entre appel à la dissolution et défense de la stabilité, elles traduisent les contradictions d’un territoire qui vit aujourd’hui la crise française à ciel ouvert.