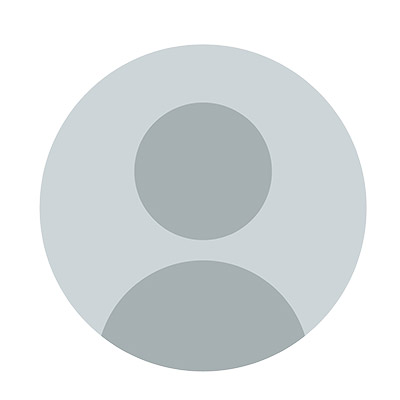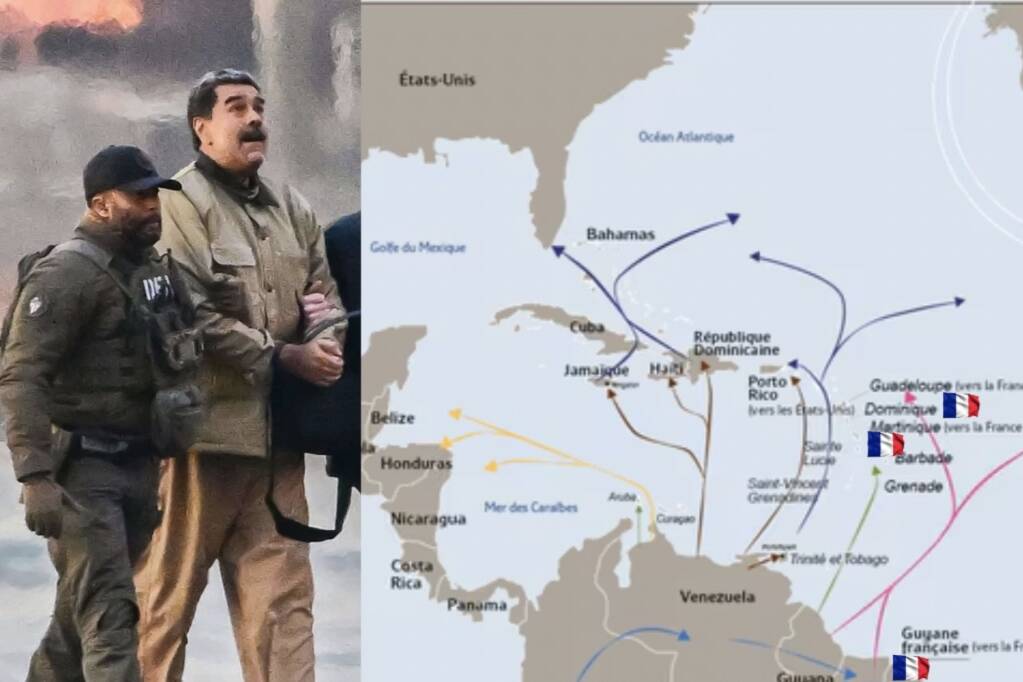Les résultats de l’étude Mataea, menée entre 2019 et 2021 sur près de 2 000 Polynésiens âgés de 18 à 69 ans et répartis dans les cinq archipels, ont été dévoilés. C’est un véritable électrochoc pour les autorités sanitaires : 78 % de la population est en surpoids et 52 % en obésité, avec une hypertension qui touche 40 % des hommes et un quart des habitants atteints de diabète sans même le savoir.
Cette enquête, conduite par l’Institut Louis Malardé en partenariat avec l’Institut Pasteur et plusieurs institutions locales, confirme que la génétique n’explique pas cette épidémie de maladies chroniques. Comme l’a souligné le ministre Taivini Teai, « il faut casser le cliché » d’une prédisposition polynésienne : ce sont bien l’alimentation déséquilibrée et le manque d’activité physique qui pèsent lourdement sur la santé publique.
Les maladies infectieuses restent elles aussi un défi majeur. La dengue circule sur tout le territoire, y compris dans les îles les plus isolées, et l’hépatite B continue de sévir, notamment aux Marquises et aux Australes, malgré la vaccination obligatoire depuis 1996. Cette infection demeure un facteur de risque élevé de cancer du foie.
Les chercheurs rappellent aussi les disparités entre archipels. Ainsi, la ciguatera – intoxication alimentaire liée à certains poissons – touche massivement les Gambier, où près de 9 % des habitants en ont été victimes à répétition, contre seulement 0,2 % dans les îles du Vent.
En réponse, le gouvernement local mise sur des programmes concrets, comme Tavivat, qui vise à introduire dans les cantines scolaires une alimentation issue majoritairement de la production locale, avec plus de fruits, légumes et poissons du fenua. Une manière de conjuguer santé publique, autonomie alimentaire et réduction des importations.