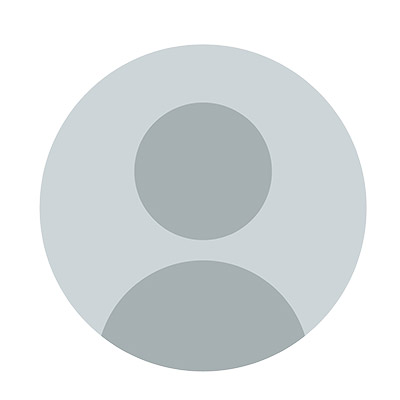Mayotte n’est pas seulement une île de l’océan Indien bordée par l’un des plus grands lagons du monde. Depuis 2010, elle abrite aussi le premier parc naturel marin d’outre-mer, vaste de 69 000 km². Un espace unique où lagon, récifs coralliens, mangroves et herbiers marins cohabitent avec des usages essentiels : pêche, tourisme et culture locale. Mais cet écrin de biodiversité est aujourd’hui sous forte pression.

Des coraux fragilisés par Chido
En décembre 2024, le cyclone Chido a durement frappé Mayotte. Selon une étude du Parc, la mortalité moyenne des coraux atteint 45 %, avec des pics à 88 % sur les zones exposées au nord-est. Ces pertes s’ajoutent à un épisode de blanchissement majeur lié à El Niño. Résultat : une biodiversité menacée, des stocks de poissons fragilisés et une protection naturelle du littoral affaiblie. Préserver les récifs survivants est devenu la priorité, en réduisant toutes les pressions humaines : rejets en mer, ancrages sauvages, pêche intensive.

Règlementation renforcée en mer
Face à ces défis, le Parc est obligé de multiplier les actions. Concernant la pêche, des quotas stricts sont instaurés (10 poissons seul, 20 à plusieurs, maximum 5 par catégorie), des fermetures saisonnières entreprises (crustacés de novembre à mars, poulpes d’avril à mi-juin) et des espèces protégées comme les raies manta, les napoléons ou les tortues marines. Concernant la plaisance : les installations de bouées d’amarrage sont limitées à 24 heures, les mouillages sauvages sur des sites sensibles sont interdits (passe en S, N’Gouja, Saziley, Papani, îlot Mbouzi), et les jet-skis et engins motorisés doivent rester hors lagon, à plus de 300 mètres des plages.
Une biodiversité sous surveillance
Malgré les pressions, Mayotte reste un haut lieu mondial de biodiversité : baleines à bosse, dauphins, cinq espèces de tortues marines… Mais certains signaux sont alarmants : il ne resterait qu’une dizaine de dugongs dans les eaux mahoraises, tandis que le crabier blanc ne subsiste qu’en cinq colonies.
Pour inverser la tendance, le Parc s’appuie sur la science mais aussi sur la population : retraits de déchets post-cyclone, suivis citoyens via l’application TsiÔno, actions pédagogiques dans les écoles et auprès des pêcheurs.