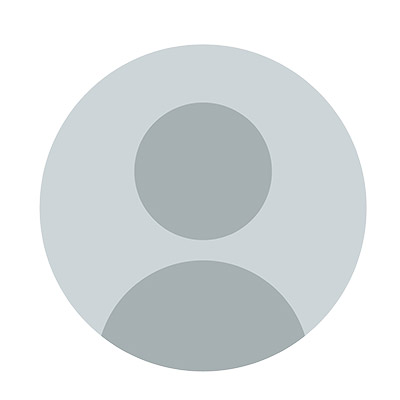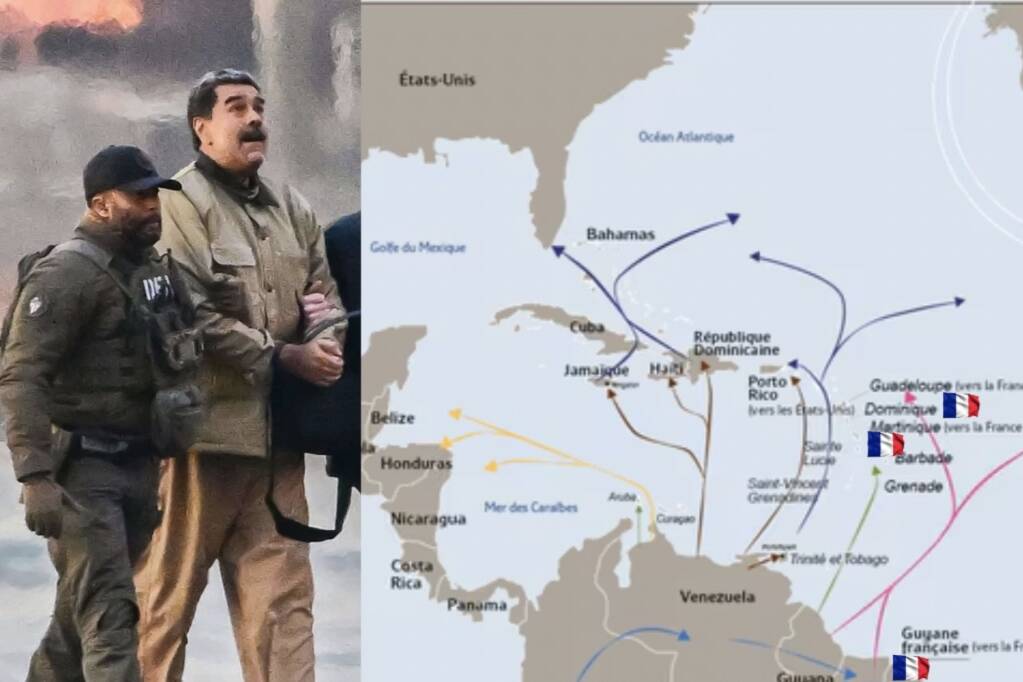En Polynésie française, les plages disparaissent peu à peu. À Moorea, elles représentaient près de la moitié du littoral en 1977, contre seulement 20 % aujourd’hui. À Temae comme ailleurs, la mer grignote parcelles privées et espaces publics. Et les murs de protection ou les enrochements, loin d’arrêter le phénomène, aggravent l’érosion.
Des associations misent sur la revégétalisation
Face à ce constat, plusieurs associations – dont la Tahitian Historical Society, Te Mana o te Moana et la Fape Te Ora Naho – lancent le projet Faatura te tahatai. Leur objectif : replanter des espèces adaptées, comme le naupata ou les herbacées rampantes, dont les racines retiennent le sable et stabilisent la plage. Une zone-test de 200 m² a été aménagée à Temae pour mesurer l’efficacité de cette solution naturelle. Contrairement aux ouvrages artificiels, ces plantes s’ancrent durablement et offrent une protection résiliente face aux houles et aux cyclones.
Au-delà de l’impact sur l’habitat humain, l’érosion menace aussi la biodiversité. Les tortues marines, par exemple, peinent de plus en plus à pondre à Tetiaroa, bloquées par des marches d’érosion ou contraintes de nicher trop près de l’eau.
Le dérèglement climatique accentue encore le phénomène. Mais les spécialistes rappellent que les anciens savaient bâtir loin des côtes, conscients de la dynamique naturelle du littoral. Aujourd’hui, la Polynésie française doit conjuguer savoirs traditionnels et solutions écologiques pour freiner la disparition de ses plages et protéger son patrimoine naturel et humain.