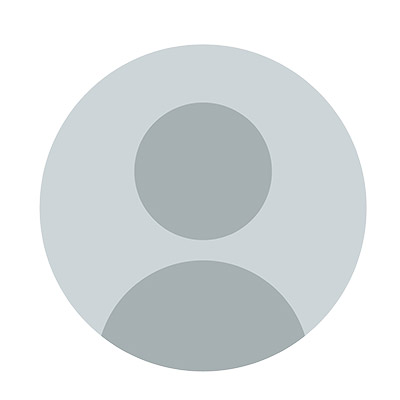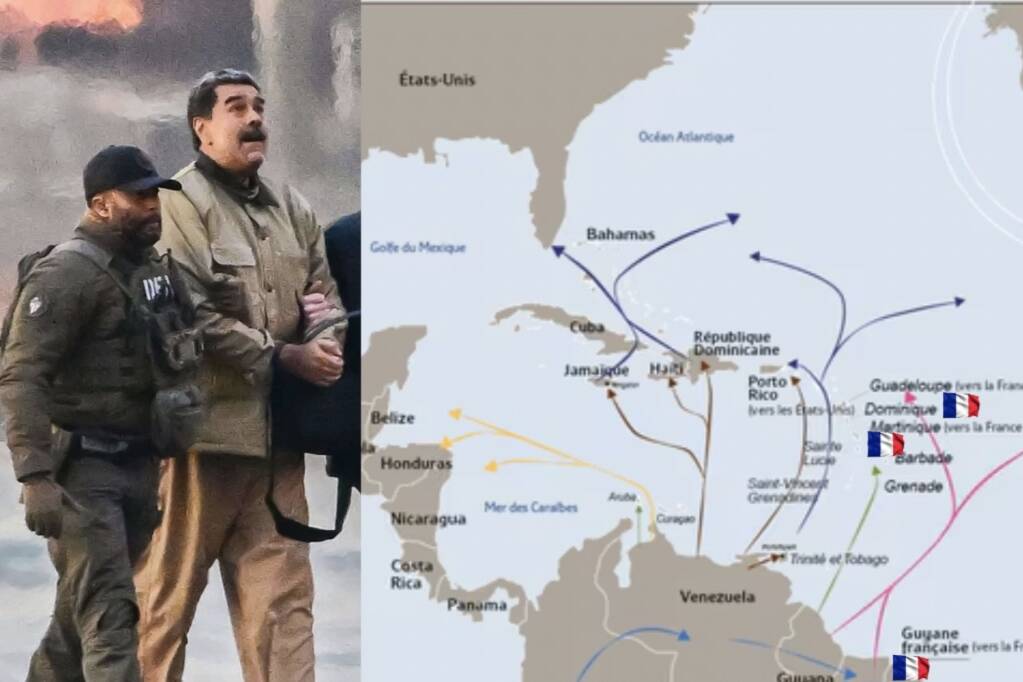La décision du ministère de l’Éducation nationale de ne pas ouvrir l’agrégation externe de créole pour la session 2025-2026 provoque une vive réaction dans les Antilles. Enseignants, syndicats et élus dénoncent un “recul symbolique” pour la reconnaissance du créole comme langue vivante régionale.
Selon le rectorat de Martinique, cette suspension n’est pas un désaveu, mais le résultat d’une régulation nationale des concours, appliquée à toutes les disciplines en fonction des besoins de recrutement. Le directeur académique adjoint Léonce Belfan a rappelé que le CAPES créole reste, lui, ouvert cette année, permettant le maintien d’un vivier de professeurs sur le territoire. L’agrégation, indique-t-il, sera rouverte en 2027, une fois la réorganisation achevée.
Mais les explications officielles ne convainquent guère. Le SPEG en Guadeloupe et le SE-UNSA en Martinique dénoncent un “traitement inéquitable”, alors que les agrégations de breton, corse et occitan sont, elles, maintenues. La députée Béatrice Bellay y voit une marque de “mépris institutionnel” envers la langue créole et ses locuteurs.
Au-delà du concours, l’affaire illustre un sentiment d’inégalité persistante entre les territoires ultramarins et la métropole. Le créole, langue française de culture et d’histoire, peine encore à obtenir la même reconnaissance que les autres langues régionales. Une situation paradoxale, alors que l’État affirme vouloir renforcer la cohésion républicaine et la diversité linguistique.
L’enjeu dépasse la simple question administrative : il s’agit d’un combat pour la place du créole dans la République, entre attachement identitaire et exigence d’égalité.